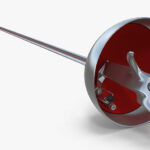LQ 932 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 932 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 927 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 927 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien

LQ 926 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 926 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 925 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 925 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 923 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 923 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 914 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 914 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 912 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 912 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
LQ 910 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
N° 910 – Dimanche 24 janvier 2021 – 20 h 38 [GMT + 1] – lacanquotidien.fr
Silences et secrets
Inceste et secrets de famille Familles, ques@ons cruciales, la chronique d’Hélène Bonnaud
Le consentement au nom de La familia grande par […]
LQ 910 ←Pour consulter le numéro, veuillez cliquer sur ce lien
N° 910 – Dimanche 24 janvier 2021 – 20 h 38 [GMT + 1] – lacanquotidien.fr
Silences et secrets
Inceste et secrets de famille Familles, ques@ons cruciales, la chronique d’Hélène Bonnaud
Le consentement au nom de La familia grande par Clo@lde Leguil
Exilées de l’être mère par Yohann Allouche Inceste et secrets de famille
Familles, questions cruciales, la chronique d’Hélène Bonnaud
L’inceste est une forme d’attentat sexuel longtemps restée dans le non-dit et l’impunité, alors que l’on sait pourtant que les répercussions sur le plan psychique en sont immenses. L’inceste est marqué du sceau du silence et de la honte, deux signifiants majeurs qui en traduisent l’effet sur celui qui l’a subi. Le silence est, le plus souvent, une condition imposée par qui commet ce crime, qu’il s’agisse d’un père, d’un frère, d’un oncle, etc., ou encore, plus rarement, d’une mère, d’une sœur. À l’heure où l’on dénonce les affaires de viol, de harcèlement sexuel, mais aussi moral, à l’heure où l’on dénonce l’emprise dans le couple et ses violences, les actes de pédophilie dans le monde du cinéma, du sport ou de la religion, l’inceste a une place particulière en tant qu’il se produit au sein de la famille, entre ses membres. La famille est avant tout garante de la protection de l’enfant, et spécifiquement de l’interdit de relations sexuelles entre adulte et enfant – entre l’enfant et ses parents en premier lieu, mais aussi avec d’autres personnes de l’entourage familial.
Le crime d’inceste est aujourd’hui passible de prison, mais la loi qui le signifie comme tel n’est pas très ancienne : elle date de 2016 (1). Cette loi récente a d’ailleurs dû être révisée. En effet, le texte du 14 mars 2016 dénommait inceste les infractions sexuelles commises par les ascendants, la fratrie ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, uniquement sur un mineur, ce qui, deux ans plus tard, le 3 août 2018, sera étendu à toute victime, mineure ou non (2). Désormais, lorsque les agressions sexuelles sont commises sur un mineur, le juge doit prendre en considération l’autorité exercée par l’auteur, la différence d’âges entre la victime et l’auteur et son absence de maturité en tant qu’élément démontrant la contrainte ou la surprise (3). Par ailleurs, le Code pénal (4) exige que toute juridiction saisie d’une agression incestueuse sur mineur par un titulaire de l’autorité parentale se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité à l’auteur. L’inceste est donc resté très longtemps en marge de la loi. Le législateur a-t-il évité cette question par crainte de mettre en danger la famille ? Pourtant la reconnaissance de l’inceste constitue plutôt une protection élémentaire de son devenir. Cela doit nous interroger sur la valeur d’idéalisation de la famille, qui a longtemps prévalu comme modèle social intouchable, seul garant de la filiation ; le droit de la famille visait à établir un lien symbolique entre les parents et les enfants garantissant la succession des générations, et cela, quel qu’en soit le prix payé concernant les abus et les violences qui s’y commettent.
Pour la psychanalyse, l’inceste implique la loi, mais aussi les sujets. L’inceste est un nœud de jouissance entre deux parlêtres. Il met en jeu la perversion de celui qui l’accomplit et aliène l’enfant qui le subit. Il n’est pas facile d’en parler d’une façon générale, chaque situation étant finalement ce qui permet d’en mesurer les conséquences. Il n’y a pas de pour tous, et encore moins dans l’inceste qui ne prend sens, bien souvent, que dans l’après-coup.
Témoignages et secrets
Depuis quelques mois, nous entrons dans le vif d’un sujet qui aujourd’hui s’éclaire autrement, du fait de l’impact des réseaux sociaux où la parole s’adresse à l’Autre de la vox populi et l’investit comme témoin de l’affaire, mais aussi comme juge de ceux qui sont mis en cause ou mis en accusation de viol, d’inceste, de violence. Cette mise en accusation publique prend parfois des airs de justice expéditive et interroge aussi bien les moyens que la finalité de ces dénonciations. Si l’adresse à l’Autre est constante, la parole est toujours appelée à révéler une vérité essentielle pour le sujet.
En effet, « parler » prend valeur de témoignage nécessaire à faire cesser l’insupportable du silence. Dans le livre de Vanessa Springora, Le Consentement (5), paru il y a juste un an, cette dimension était au premier plan. La parole, longtemps tue, doit se libérer. Il y a un moment subjectif où la position de tacere, se taire, devient insupportable au sujet. Jacques-Alain Miller, dans son cours Silet, introduit la différence entre se taire et se faire silencieux : « quand on dit se taire, il y a toujours l’idée qu’on se tait ou qu’on vous fait taire, alors que silet c’est plutôt l’idée de garder le silence » (6), comme le fait l’analyste. En effet, c’est dans ce registre du tacere à la prise de parole que nous pouvons situer le passage à l’écriture comme témoignage.
Ainsi, dans le récent livre de Camille Kouchner, La Familia grande (7), l’écriture vient révéler un attentat sexuel longtemps gardé secret, perpétré sur son frère jumeau par son beau-père. Pour elle aussi, le silence a fait longtemps symptôme, signe d’une violence psychique imposée aussi bien par soi-même que par celui qui ne veut pas que ça se sache. Dans ce cas, il semble que le frère ait longtemps préféré ne pas révéler la vérité pour ne pas faire souffrir sa mère. En voulant protéger sa mère, il a aussi protégé son agresseur. Ainsi, le couple parental a fonctionné dans la jouissance de ne rien vouloir savoir, du côté de la mère, et dans le déni de l’abus, pour le beau-père. Secret et culpabilité Il y a donc une jouissance à se taire qui touche à la domination de l’agresseur, mais aussi à la parole en tant que le secret en maintient le pacte, tacitement ou pas. Le secret vient sceller la relation du violeur avec l’enfant violé, condition toujours teintée de culpabilité. Qu’il s’agisse alors de dénoncer le secret qui protège le violeur, permet de libérer non seulement la parole du secret partagé, mais aussi de la culpabilité qui y était attachée. Secret et culpabilité forment un couple qui aliène le sujet à l’Autre jouisseur, lui donnant tout pouvoir et lui permettant de maintenir le lien pervers avec son objet. D’autre part, le secret, dans les cas d’actes violents ou pervers au sein de la famille, soude imaginairement les liens entre les sujets, et grossit le sentiment d’être tenus par un pacte de parole symbolique alors qu’il s’agit, au contraire, d’un faux pacte de parole imposé par l’agresseur. Le secret apporte alors son lot de dépression et de culpabilité car il touche à ce que la parole y est, de fait, interdite et cela, sous couvert d’intimité partagée.
Sortir de ce silence-là, c’est perdre quelque chose de cette jouissance qui promet le semblant d’union, le semblant de famille une. Il faut, en effet, un certain courage. Il faut, non seulement affronter la colère de l’agresseur, mais aussi le regard mauvais de tous ceux qui savaient et se taisaient. Il faut faire la différence entre parler pour soi, et parler pour l’autre, pour celui qui est cause de ce qui s’écrit.
Le témoignage qui met d’accord et l’autre Dans le Séminaire Les psychoses, Lacan parle du témoignage à plusieurs reprises. Le témoignage est-il communication ? Il répond non. Cependant, dit-il, tout ce qui a valeur de communication est de l’ordre du témoignage. Il fait la critique de la communication pointant « qu’il s’agit d’un témoignage raté, soit quelque chose sur quoi tout le monde est d’accord » (8) et l’illustre par l’idéal de la transmission de la connaissance. Le témoignage fonctionnerait alors comme une communication qui mettrait tout le monde d’accord. Mais il y a une autre valeur donnée au témoignage, poursuit Lacan : « ce n’est pas pour rien que ça s’appelle en latin testis, et qu’on témoigne toujours sur ses couilles. Dans tout ce qui est de l’ordre du témoignage, il y a toujours engagement du sujet, et, lutte virtuelle à quoi l’organisme est toujours latent ». (9) Le témoignage tient au corps, c’est un effet du corps sexuel plus précisément. En cela, le témoignage qui vient dire une vérité jusque-là cachée est résonnance de ce que le sujet qui parle a un corps, affecté par un dire resté longtemps inavouable. Cela n’est pas sans évoquer la belle formule de Lacan concernant la fin de l’analyse et le témoignage de passe (10) lui-même, quand il précise : « les pulsions, c’est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire » (11). Disons que dans tout témoignage, il y a quelque chose qui se dit où le corps est latent.
Hors de la famille La vérité n’éclate plus au sein de la famille, mais au grand jour, d’autant plus quand la personne mise en accusation est célèbre. Ne pouvant porter plainte contre elle — la prescription ne le permet plus —, le témoignage prend ici des formes jusqu’alors inédites. Kaput le dicton selon lequel “le linge sale doit se laver en famille”, dès lors que s’ouvre un nouvel espace pour dire ce qui, de ladite famille, fait la beauté comme la nuisance, et que vient s’y dire, hors de l’étouffoir qu’elle impose, la fascination qu’elle recèle. La famille, c’était ça, et plutôt que de l’extraire de soi, on s’en extrait, soi. À l’évidence, à l’intérieur de la famille, lieu clos qui maintient l’homéostase à tout prix, les secrets font fonction de stabilisateurs des liens au nom de l’amour, alors qu’il s’agit avant tout de faute. Celle-ci vient se dire dans le sentiment de culpabilité. N’est-ce pas aussi ce qui pousse à révéler la vérité verrouillée par le secret. C’est à cause de cette faute innommable qu’il y a levée de ce que le sujet s’autorise à dire. Et il peut trouver à s’en séparer dans le témoignage d’écriture.
Raconter, pourtant, ne lève pas forcément la culpabilité. Cela peut la voiler un moment, mais celle-ci fait retour. Elle reviendra là où elle touche au réel, qui est « ce qui revient à la même place » (12), mais aussi ce qui n’a pas de loi car « Le réel n’a pas d’ordre » (13). La culpabilité décuple l’effet-sujet en même temps qu’elle voile le hors-sens dont il s’agit dans le fait de témoigner d’un inceste. C’est toute la différence qu’il y a entre Parler de moi pour dire ma vérité à tous et Parler de moi pour savoir ce que j’en sais dans ce que j’en dis, ce qui est fondamentalement la position de l’analysant.
Le témoignage est alors une extraction qui fait de la vérité, une réponse autre, autrement menteuse, autrementeuse comme un roman est sans foi ni loi.
1. Une tentative précédente (loi du 8 février 2010) a été abrogée rapidement (17 septembre 2011).
2. Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 – l’article 222-31-1 du Code péna l est ainsi modifié : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
3. L’article 222-22-1 du Code pénal dispose en outre que « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »
4. Cf. article 222-31-2 du Code péna l modifié par la loi n° 2016-97 du 14 mars 2016.
5. Springora V., Le Consentement, Grasset, 2020.
6. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Silet », cours du 23 novembre 1994.
7. Kouchner C., La Familia grande, Seuil, 2021.
8. Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les psychoses, Paris, Seuil, 1981, p. 49.
9. Ibid., p. 50.
10. À l’issue de la procédure de la « passe » instituée par Lacan, l’Analyste de l’École (AE) est invité à témoigner de son parcours analytique et de la fin de son analyse. Chaque « témoignage de passe » a valeur d’enseignement.
11. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 17.
12. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, 1973, p. 49.
13. Lacan J., Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 138. Le consentement au nom de La familia grande
par Clotilde Leguil
Au nom de quoi le sujet consent-il à ce que, pourtant, il ne désirait pas ? Au nom de quoi se laisse-t-on faire, quitte à en payer le prix par « une immense culpabilité d’exister (1) » ? Le livre de Camille Kouchner La Familia grande, après celui de Vanessa Springora sur Le Consentement, nous conduit aux racines de l’expérience énigmatique du consentement. Car le consentement n’est pas seulement une affaire de sujet libre et éclairé. Il touche au plus intime d’un sujet, qui a besoin pour exister de faire confiance à quelqu’un. En ce sens, celui qui trahit un consentement instrumentalise la confiance et la foi en la parole.
Dans ce livre, il est en effet question d’une affaire de consentement, qui nous montre que l’abus peut commencer subrepticement simplement depuis ce qui est entendu, ce qui est su, et qui vient s’immiscer au cœur de la vie intime d’un être, ici d’une adolescente. « Il entrait dans ma chambre et par sa tendresse et notre intimité, par la confiance que j’avais pour lui, tout doucement, sans violence, en moi, enracinait le silence (2) », écrit-elle. L’abus, c’est ici l’emprise qui fait taire le sujet sans même que celui-ci ne s’en aperçoive. Ce que Camille Kouchner démontre ainsi, c’est que faire confiance lorsqu’on a quatorze ans est une condition indispensable pour loger son être. Avoir foi dans les paroles d’un à qui on s’en remet, c’est croire en l’Autre, mais aussi dans le monde. Comment exister sinon ?
Entre céder et consentir
« Ma culpabilité est celle du consentement. Je suis coupable de ne pas avoir empêché mon beau-père, de ne pas avoir compris que l’inceste était interdit » (3) : Camille Kouchner se sent coupable de son propre consentement. Mais doit-on penser que l’adolescente qui se tait – comme le lui demande son frère par ces mots : « si tu parles, je meurs (4) » – consent vraiment à ce silence ? Est-ce parce qu’elle garde secrète la confidence que son frère lui a faite à elle, et qu’elle obéit, sous le coup de l’emprise, à ce silence que lui impose son beau-père, qu’elle consent ? Si le consentement peut ouvrir la voie à l’abus et plus précisément à un « se laisser abuser », en tous les sens du terme, c’est aussi qu’il y a une zone trouble entre « céder » et « consentir ». Je voudrais revenir à travers la lecture de ce livre sur l’aphorisme « céder n’est pas consentir », pour montrer à quel point la frontière entre « consentir » et « céder » est à la fois nécessaire et en même temps précaire.
En un sens, et comme elle le dit, elle a consenti, c’est vrai. Mais elle a consenti sans savoir à quoi elle consentait, elle a consenti à ce qu’elle n’a ni compris ni choisi. Son consentement au silence ne se fonde pas tant sur une insondable décision de l’être qu’il n’est déjà l’effet du trauma. Elle a cédé à la situation plus qu’elle n’y a consenti, forcée par son beau-père de choisir entre « perdre le monde qui était le sien », celui de la familia grande, ou se taire. Ce récit permet ainsi d’approcher cette frontière entre « céder » et « consentir », où apparaît que, quelquefois, un sujet ne dispose pas des moyens de dire « non ».
À propos du suicide de Paula, sa grand-mère, événement tragique qui précède l’abus sexuel par son beau-père sur son frère jumeau, Camille Kouchner écrit : « Ce jour-là, j’ai été ensevelie par la peur » (5). Dès lors vacillent les fondations de son monde suite à ce suicide, c’est alors que sa mère sombre et n’est plus là pour elle, c’est alors aussi que son beau-père, adoré jusque-là, abuse de son frère jumeau. L’adolescente de quatorze ans s’est donc tue, médusée par l’emprise de cet homme venu se loger à la place du père qui lui manque. Elle s’est tue en proie à la peur qu’un autre drame surgisse, qu’un suicide se répète dans la famille, celui de sa mère gravement fragilisée par la perte violente de sa propre mère. La culpabilité de ne pas avoir su dire « non », la culpabilité d’avoir dit « oui » à ce qu’elle n’a pas compris en se taisant, est désormais ce qui la hante, l’hydre qui l’empoisonne, comme elle la nomme.
Cette plongée aux racines du consentement nous montre qu’à l’origine de la culpabilité ressentie, suite au traumatisme sexuel et psychique, une expérience du « se laisser faire » fait retour pour le sujet sous forme d’énigme. Pourquoi se laisse-t-on faire par l’autre ? « J’avais 14 ans et j’ai laissé faire. J’avais 14 ans et en laissant faire, c’est comme si j’avais fait moi-même. J’avais 14 ans, je savais et je n’ai rien dit » (6). Le sujet abusé par l’autre se reproche après coup d’avoir cédé à une situation qui forçait son consentement. Le sentiment de la faute, de sa faute est ici le stigmate de l’expérience du « se laisser faire » sous le coup de l’emprise. Mais au nom de quoi finalement le sujet se laisse-t-il faire ?
Au nom de…
Il y a toujours un « au nom de », qui fait consentir et fermer les yeux. Il y a toujours un « au nom de » qui pousse à se laisser faire. Il y a toujours un « au nom de », qui invite à la démission de soi-même. Mais c’est aussi « au nom de » que le sujet peut un jour se réveiller et désobéir enfin, s’extraire de la soumission qu’il s’est imposée. Si c’est au nom de la familia grande et de l’amour pour sa mère que Camille Kouchner a consenti un temps au silence, c’est peut-être aussi au nom de ce que signifie maintenant pour elle être une sœur, au nom de ce que signifie d’être devenue mère et s’inquiéter de sa transmission, que Camille Kouchner parvient à désobéir. À la façon d’Antigone – qui ne cède pas sur son être sœur –, Camille Kouchner dévoile, trente ans après, la part cachée de la familia grande. Son livre est un acte de courage. Après Le Consentement de Vanessa Springora, où l’auteur s’affrontait à son propre consentement à l’abus, La familia grande pose la question de la désobéissance, dans un milieu dont les maîtres mots étaient la liberté et « l’interdit d’interdire ». C’est aussi la force de ce récit que de révéler ce qui peut se nicher derrière la revendication de la liberté : un déchaînement de jouissance qui abandonne le sujet à son angoisse, ne sachant plus où se trouve son désir, ne sachant plus non plus quelle est sa place. C’est cette place qu’elle retrouve en écrivant en son nom sur cet abus.
La peur reporte l’instant de déchirer le voile et pousse le sujet à fermer les yeux sur ce qui fait que le monde est quelquefois immonde, comme le disait Lacan. Le prix à payer pour l’accès à son propre « Je » est alors un autre consentement, un consentement à dire, un consentement aussi à la perte du monde dans lequel on a cru. Enfin, trente ans plus tard, Camille Kouchner parvient à se libérer de ce silence et à « empoisonner l’hydre en achevant ce livre » (7).
1. Kouchner C., La Familia grande, Seuil, 2021, p. 122.
2. Ibid., p. 107.
3. Ibid., p. 126.
4. Ibid., p. 105.
5. Ibid., p. 97.
6. Ibid., p. 204.
7. Ibid. Exilées de l’être mère
par Yohann Allouche
À propos du dernier livre de David Grossman, La vie joue avec moi * .
Vera, Nina, Guili. Trois prénoms, trois femmes, trois générations. Guili incarne au dernier degré la lettre en souffrance (1), dont le sens retranché circule pourtant depuis le choix insoutenable de sa grand-mère Vera, d’abandonner sa fille de 6 ans et demi, Nina.
Eva Panic-Nahir, dont Vera est inspirée, a confié son histoire à David Grossman durant une amitié de vingt années afin qu’un jour il en fasse un livre, son livre. Du récit de cette femme au caractère bien trempé, immigrée yougoslave en Israël, naît un roman percutant, où l’imagination relève la finesse, dans ce rendez-vous avec un réel que permet l’écriture. L’auteur aborde les questions du deuil, de la transmission, du secret, mais j’ai choisi de déplier ici celles du ravage maternel et du désir d’être mère.
Instinct maternel ?
À rebours d’un supposé instinct maternel recouvrant « la fausse évidence du lien naturel et de l’universel du désir d’enfant » (2), ces trois femmes se présentent comme des exilées de l’être mère. Ce livre témoigne des embrouilles et des non-dits entre mères et filles.
Vera fut arrêtée puis internée en Croatie, sous Tito, au camp de l’île-goulag de Goli Otok. Pour que l’histoire familiale se dise, un dispositif de type cinématographique est mis en place, avec l’idée que, prononcés face caméra, les propos ordinaires « frappent [chacun] comme s’il les entendait pour la première fois, et l’histoire qu’il se raconte depuis tant d’années vole en éclats » (3). Guili, la petite-fille, est celle qui filme ce témoignage tout en prenant des notes. Elle se fait « scripte » afin d’« assurer la continuité ». Vera est celle qui raconte son histoire comme elle ne l’a jamais fait, poussée par sa fille Nina à lever le voile du secret. Quel est ce secret ? Interrogée par un agent des services secrets yougoslaves (l’UDBA), suite au suicide de son mari suspecté de trahison d’état, Vera est confrontée à un choix éthique : signer des aveux, ce qui salirait l’honneur de son mari mais lui permettrait de repartir libre avec sa fille, ou bien partir au camp et livrer sa fille « à la rue ». La question de l’agent ne la divise pas : « Tu préfères un homme mort à une fillette vivante ? » (4) Son choix est fait. Elle ne peut trahir cet homme ni ses idéaux, encore moins avilir leur histoire d’amour. Elle accepte d’en payer le prix : abandonner sa fille. Là, « la femme étouffe la mère » (5), pour reprendre l’expression de Philippe De Georges dans Mères douloureuses.
Vera vient de perdre l’amour de sa vie, celui qui comptait « plus que [sa] propre vie ». Vera déclare : « Je suis plus une mère, je suis plus une femme, je suis plus un être humain. Je suis rien. » (6) Dès lors – Jacques-Alain Miller le dit à propos de Médée –, elle « n’a plus rien à perdre » (7). Comme épinglé par Lacan, ce qu’une femme est prête à faire pour un homme dépasse le don de soi. L’acte d’« une vraie femme, dans son entièreté de femme » (8), s’étend à sacrifier ce qu’elle a « de plus précieux ». Vera ne peut « consentir à n’être que […] mère, déchue de la place qu’elle tenait du désir de l’homme qui est le sien » (9). Sa vie durant, elle chantera l’amour de son homme.
1, 2, 3… nous sommes des parias La vie joue avec moi est le titre du livre. Comme le formule P. De Georges, d’une part « la vie de chaque personne [est] un condensé anthropologique. Chaque moment crucial est le croisement entre des relations qui s’établissent dans l’instant, l’ici et maintenant, et une chaîne où cheminent tous les mots qui ordonnent notre rapport à la vie et au désir », et d’autre part « le choix de chaque sujet multiplie les réponses possibles » (10).
Le choix implacable de Vera sera lourd de conséquences, il inscrit un prix à payer qui fait trace dans la relation des mères à leur fille. Suivons le trajet subjectif de chacune. Nina, peu habitée par le sentiment de la vie, ne pourra assumer son être mère et abandonnera à son tour sa fille Guili en bas âge. Sans attaches, en errance, elle n’aura de cesse de partir à la recherche d’hommes qui la « désirent » (11), qui la « choisissent » elle.
Quant à Guili, à la troisième génération, elle aurait eu bien besoin, dit-elle, « d’une mère, même d’une mère cinglée, même d’une mère volage, mais, au moins, d’une femme qui la regarde de temps à autre de femme à femme, qui étreigne son corps désemparé et qui lui révèle, ravie, à quel point elle est femme » (12). Lacan souligne « le fait du ravage qu’est chez la femme, pour la plupart, le rapport à sa mère, d’où elle semble bien attendre comme femme plus de substance que de son père » (13). Or c’est probablement moins l’absence que la manifestation d’une jouissance énigmatique et illimitée chez la femme qu’est sa mère, qui plonge Guili dans le ravage. Parviendra-t-elle alors à passer d’une identification de « paria de l’enfantement » (14) à celle d’une « mère avec des attaches » (15) ? Une île de douleur
L’œuvre de David Grossman est traversée par la question du deuil qu’il compare à un « exil » dans une « île de douleur » (16) que son écriture est une manière de « cartographier ». Ici, il me semble que le deuil prend la forme de l’abandon maternel.
Lors d’une conférence intitulée « Exil et séparation » (17), François Ansermet indiquait une issue à l’hilflosigkeit de l’exilé(e) : en passer « paradoxalement par la séparation, non pas avec l’autre, mais avec soi-même ». Chacune des protagonistes de La vie joue avec moi aurait alors à se départir d’un point de douleur exquise liée au secret, lourd fardeau identificatoire.
Vera, Nina et Guili regagnent ensemble Goli Otok, cette « île de douleur » où leur vie s’est inlassablement rejouée, afin de renouer l’espace, le temps, les images et les mots.
Animées par l’espoir de se délester du poids de jouissance mortifère de ce passé, elles feront un choix d’un autre style. À retisser les mailles de la vie, la troisième génération ne perpétuera peut-être pas l’exil de l’être mère. Guili devra renoncer à la haine éprouvée pour sa mère, et se séparer d’une identification à la mère qui abandonne, afin d’accéder au désir bien vivant d’être mère.
* Grossman D., La vie joue avec moi, Paris, Seuil, 2020.
1. Cf. Lacan J., « Le séminaire sur La lettre volée », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 11 .
2. D. Laurent, « Le désir d’enfant à l’heure de la science : incidences cliniques », Letterina, Bulletin de l’ACF Normandie, n°63, 06/2014, p. 28
3. Grossman D., La vie joue avec moi, op. cit., p.109. 4 Ibid., p.257.
5. De Georges P., Mères douloureuses, Paris, Navarin / Le Champ freudien, 2014, p. 98.
6. Grossman D., La vie joue avec moi, op. cit., p.257.
7. Miller J.-A., « Médée à mi-dire », La Cause du désir, n° 89, 2015, p. 114.
8. Lacan J., « Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 761.
9. Miller J.-A., « Médée à mi-dire », op. cit., p. 114.
10. De Georges P., Mères douloureuses, op. cit., p. 110.
11. Grossman D., La vie joue avec moi, op. cit., p. 187.
12. Ibid., p. 55.
13. Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 465.
14. Grossman D., La vie joue avec moi, op. cit., p. 100.
15. Ibid., p.210.
16. Entretien de D. Grossman avec C. Alberti et G. Caroz, « D’une peur existentielle », Lacan Quotidien, n os 552 & 553, 13 & 15 décembre 2015.
17. F. Ansermet F., conférence de à l’Université de Genève sur le thème « Exil et séparation », 2016, disponible sur Radio Lacan ici. Lacan Quotidien, « La parrhesia en acte », est une production de Navarin éditeur
1, avenue de l’Observatoire, Paris 6 e – Siège : 1, rue Huysmans, Paris 6 e – navarinediteur@gmail.com
Directrice, éditrice responsable : Eve Miller-Rose (eve.navarin@gmail.com).
Éditorialistes : Christiane Alberti, Pierre-Gilles Guéguen, Anaëlle Lebovits-Quenehen. Maquettiste : Luc Garcia.
Relectures : Sylvie Goumet, Michèle Rivoire, Pascale Simonet, Anne Weinstein. Électronicien : Nicolas Rose.
Secrétariat : Nathalie Marchaison.
Secrétaire générale : Carole Dewambrechies-La Sagna.
Comité exécutif : Jacques-Alain Miller, président ; Eve Miller-Rose.
pour acceder au site LacanQuotidien.fr CLIQUEZ ICI
APPEL DES PSYS CONTRE MARINE LE PEN
Twitter Lacanquotidien
RAFAH EST LIBRE !
Lacan Quotidien Archives
Lacan Quotidien Derniers Numéros
- Lacan Quotidien n° 932 – Fumaroli : la dernière leçon
- Lacan Quotidien n° 931 – « GreekJew is JewGreek » – Joyce, Ulysses
- Lacan Quotidien n° 929
- Lacan Quotidien n° 928 – 2021 Année Trans
- Lacan Quotidien n° 927 – Éric Marty et Jacques-Alain Miller – Entretien sur « Le sexe des Modernes » – Document – Lyon va adopter un budget genré
- Lacan Quotidien n° 926 – Sexualités et symptôme : refoulement, forclusion et démenti par Agnès Aflalo – La loi forclôt l’interpretation par Ricardo Seldes – Sur un article de J. Chamorro par Ramiro Tejo, réponse de Jorge Chamorro – J’entends des voix qui me parlent, film de Gérard Miller et Anaïs Feuillette
- Lacan Quotidien n° 925 – OURAGAN SUR LE « GENDER » ! par Jacques-Alain Miller – D’une époque sans nom par Christiane Alberti – La parodia de los sexos y la ley par Neus Carbonell
- Lacan Quotidien n° 924 – Que par la voie logique par Lilia Mahjoub – Crispr lalangue, crispr lenguaje par Marco Mauas – Una ley revelada par Silvia Baudini – Le Zeitgeist et ses courants : sinthome ou fake news par Pascal Pernot
- Lacan Quotidien n° 923 – Point de capiton par M. Bassols – Politique lacanienne, aujourd’hui et demain par P.-G. Guéguen – De la corrección política y sus vigilantes par L. Seguí – Espagne : la loi sur la transidentité divise les féministes par Diane Cambon pour Marianne
- Lacan Quotidien n° 922 – Monique Wittig, le pouvoir des mots par Deborah Gutermann-Jacquet – Scilicet, donc woke ou lom sans divertissement par Nathalie Georges-Lambrichs – Las seducciones de la voluntad y de la libertad par Jorge Chamorro
Publications jour par jour
avril 2024 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30